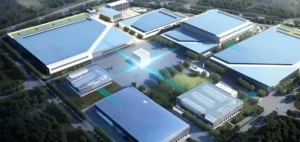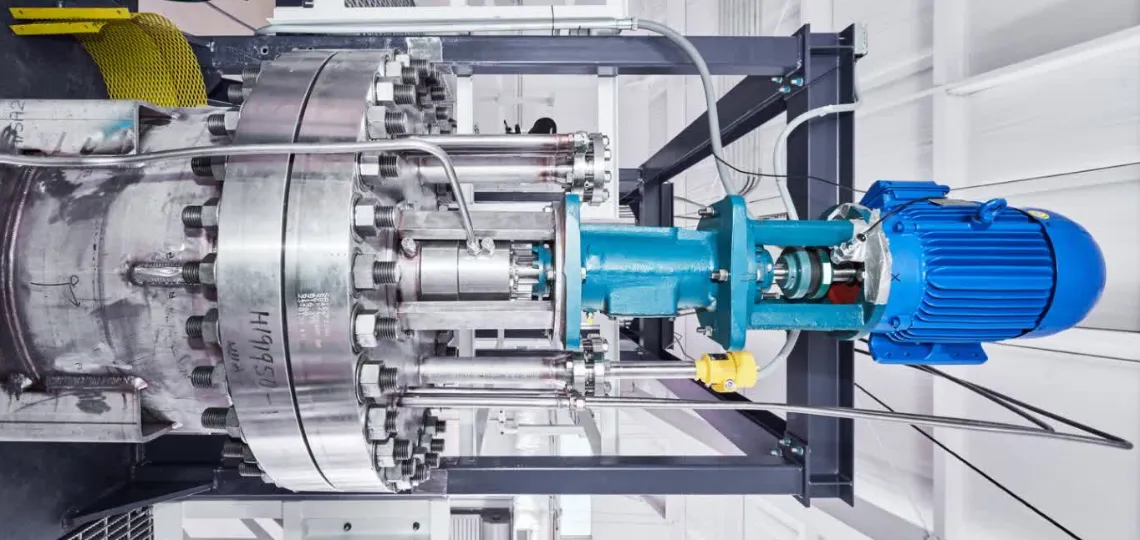Le programme de maintenance du parc nucléaire français, estimé à plus de 100 Md€ sur 2014-2035, devient un pivot industriel pour EDF. Cette enveloppe couvre des travaux indispensables à la prolongation des réacteurs jusqu’à cinquante ou soixante ans. Le chiffrage présenté par la Cour des comptes confirme que cette option demeure plus compétitive que la construction d’un parc entièrement renouvelé d’EPR2, dont les six premiers réacteurs sont évalués entre 67 et 75 Md€, auxquels s’ajoutent près de 100 Md€ de modernisation du réseau pour Enedis. La décision structure durablement la stratégie énergétique française.
Une équation financière dominée par l’État actionnaire
La prolongation du parc repose sur un coût actualisé de l’électricité (LCOE – Levelized Cost of Electricity) proche de 51 €/MWh, sous réserve d’atteindre les niveaux de production prévus entre 350 et 370 TWh en 2026-2027, puis 400 TWh en 2030. Le grand carénage dépend largement des flux générés par les installations existantes, complétés par l’endettement et des apports publics. En parallèle, le programme EPR2 bénéficie d’un prêt d’État sécurisé couvrant au moins la moitié de son coût, ainsi que d’un contrat pour différence (CfD – Contract for Difference) avec un prix plafond d’environ 100 €/MWh. La présence de l’État dans le financement et dans la régulation des prix soulève un risque de conflit d’intérêt, puisqu’il oriente simultanément la stratégie industrielle, la soutenabilité financière et la politique tarifaire.
La Cour des comptes souligne que les dépenses annuelles du grand carénage dépassent désormais 6 Md€, soit une hausse de 28 % par rapport à 2006-2014. EDF doit gérer cette charge tout en poursuivant un programme d’investissements totalisant environ 460 Md€ d’ici 2040, incluant les réseaux, les EPR2 et les renouvelables. La dette du groupe dépasse 50 Md€, malgré des résultats dépassant 10 Md€ sur les exercices récents, rendant essentielle la performance du parc existant.
Une gouvernance sous surveillance renforcée
EDF, redevenu intégralement public en 2023, exploite cinquante-sept réacteurs répartis sur dix-huit sites. La disponibilité moyenne, tombée à 74 % sur 2014-2024 contre 80 % lors de la décennie précédente, a fragilisé la trajectoire industrielle. Les visites décennales sont supervisées par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN – Autorité de sûreté nucléaire), dont les exigences post-Fukushima alourdissent le contenu du grand carénage. En matière de marchés, la Commission de régulation de l’énergie (CRE – Commission de régulation de l’énergie) surveille la formation des prix et la transparence, tandis que l’Autorité des marchés financiers (AMF – Autorité des marchés financiers) suit les obligations d’information.
La sortie du dispositif ARENH entraînera une refonte des contrats long terme pour les industriels électro-intensifs. Le code de l’énergie autorise la suspension ou la résiliation de ces contrats en cas d’abus, augmentant la pression réglementaire sur EDF pour maintenir des prix compétitifs tout en assurant ses investissements. L’intervention simultanée de l’État en tant qu’actionnaire, régulateur, financeur et arbitre tarifaire accroît la sensibilité aux accusations de conflit d’intérêt, notamment lors de la préparation des nouveaux cadres contractuels.
Enjeux de marché et tensions industrielles
Le rapport confirme que la prolongation du parc constitue le socle le moins coûteux face aux nouvelles capacités, y compris les EPR2 et les solutions renouvelables associées à des moyens d’appoint. Un parc prolongé et mieux disponible aurait un effet stabilisateur sur les prix de gros européens en ancrant un plancher nucléaire inférieur aux coûts observés en Allemagne et au Royaume-Uni, plus exposés au gaz. À l’inverse, un écart entre prévisions et performances pourrait rapprocher le coût réel du grand carénage de celui des EPR2 et accroître la dépendance aux importations.
La chaîne d’approvisionnement fait face à une saturation croissante des calendriers de maintenance et des chantiers EPR2. Les besoins en ingénierie, chaudronnerie et logistique se tendent, avec des risques de goulots d’étranglement et de renchérissement des prestations. Les partenaires industriels tels que Framatome, Enedis, les fournisseurs d’équipements et les investisseurs obligataires s’exposent à des arbitrages financiers dictés par les priorités de l’État, alimentant la perception de conflit d’intérêt entre impératifs industriels et décisions politiques.
Dimension juridique, transparence et exposition internationale
La Commission européenne surveille les mécanismes de soutien public, y compris les prêts bonifiés et les CfD, dans le cadre des règles sur les aides d’État. Le nucléaire est toutefois intégré à la taxonomie européenne sous conditions, facilitant la justification des dispositifs français. EDF a été rappelée à l’ordre par l’AMF sur des pratiques d’information financière et par la CNIL pour des questions de données personnelles, renforçant les exigences de transparence sur les coûts et les risques.
En matière de sanctions internationales, EDF ne figure sur aucune liste restrictive de l’Union européenne ni de l’OFAC, ce qui lui permet de maintenir des activités de trading et des partenariats internationaux. Cette situation nécessite néanmoins une vigilance accrue sur le choix des contreparties pour éviter tout risque indirect lié aux sanctions. Ces éléments montrent que la gouvernance d’EDF demeure soumise à un double impératif : limiter les risques juridiques et démontrer que les arbitrages rendus par l’État ne servent pas uniquement les intérêts du propriétaire public.
Une architecture de décision susceptible de cristalliser les critiques
La Cour des comptes cherche à objectiver les coûts afin de consolider la prolongation comme axe central avant la décision d’investissement EPR2 prévue en 2026. La publication d’un chiffrage supérieur à 100 Md€ mais jugé compétitif permet à l’État de verrouiller un cadre argumentaire solide face aux critiques. Le rapport contribue à calibrer les futurs prix contractuels et soutient la capacité du gouvernement à défendre un cumul d’aides publiques sans susciter de contestation européenne excessive. La position dominante de l’État dans ces arbitrages alimente toutefois un débat persistant sur le risque de conflit d’intérêt entre optimisation industrielle, objectifs budgétaires et stratégie politique.
La trajectoire française pourrait devenir déterminante pour les débats européens sur la place du nucléaire. Les résultats en matière de disponibilité, de maîtrise des coûts et de stabilité tarifaire orienteront la crédibilité de ce modèle pour les pays qui réévaluent leurs stratégies d’approvisionnement électrique.