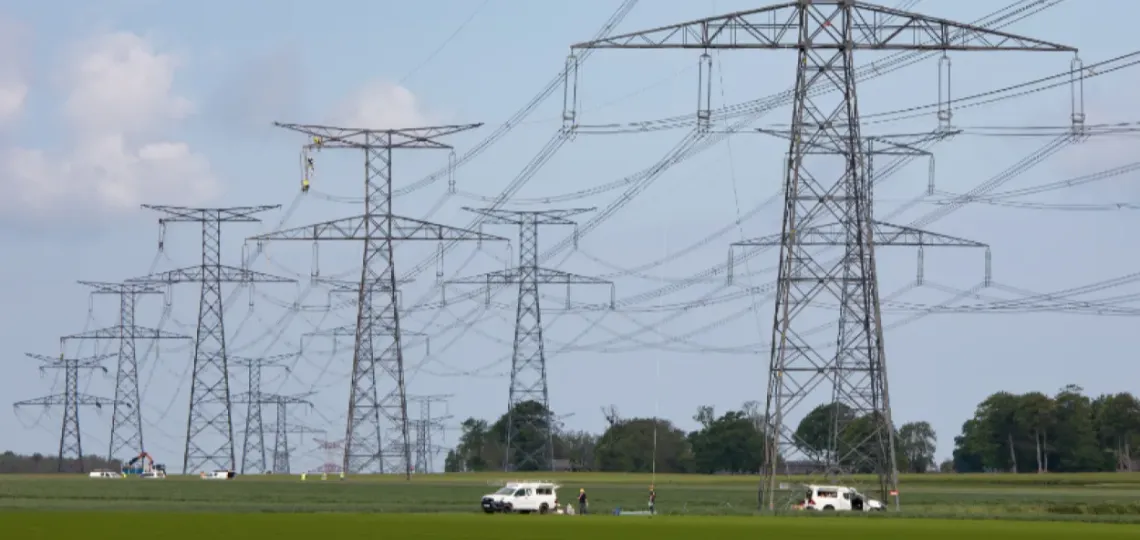L’expiration des Contracts for Difference (CfD) en Europe modifie en profondeur le profil financier des actifs renouvelables. Ces dispositifs, conçus pour garantir des revenus stables aux producteurs d’électricité verte, laissent place à une exposition intégrale aux marchés de gros, avec des conséquences directes sur les TRI (taux de rendement interne) et la valorisation des actifs.
Fin d’un modèle sécurisé et effets de levier élevés
Les CfD ont permis de transformer des projets à forte intensité capitalistique en investissements bancables grâce à une rémunération contractualisée sur 15 à 20 ans. Selon les simulations publiées par l’Oxford Institute for Energy Studies, une centrale solaire de 200 MW bénéficiant d’un CfD de 65 £/MWh pouvait supporter un levier atteignant 75 % de dette, tout en affichant un TRI actions supérieur à 10 %.
La valeur actionnariale était cependant massivement back-loadée, avec des flux distribués principalement après la fin du contrat. Ce design financier reposait implicitement sur des hypothèses de stabilité des prix et des volumes sur le long terme, hypothèses aujourd’hui remises en question par l’évolution des fondamentaux de marché et du cadre réglementaire.
Un risque accru à mesure que le CfD arrive à échéance
Les analyses du TRI montrent que de simples ajustements défavorables de -10 % sur les prix de gros, combinés à une baisse de 1 % du facteur de charge et du taux de capture, font chuter le TRI actions sous le seuil de 9 %. Le P5 – c’est-à-dire la performance du cinquième centile le plus défavorable – tombe alors à 4 %, voire négatif selon certaines trajectoires de marché simulées.
Treize ans après la mise en service, lorsque le CfD approche de son terme, l’élargissement de la distribution du TRI s’accentue. À ce stade, un même actif voit son profil de risque augmenter sans changement opérationnel, en raison de la sensibilité croissante des flux post-CfD à la volatilité des prix.
Impact sur les décisions financières et opérations secondaires
Les options de refinancement ou de couverture tardives, telles que des hedge partiels de 30 à 90 % sur trois ans roulants ou un refinancement sur 10 ans à partir de l’année 14, permettent d’augmenter légèrement le TRI moyen, mais aggravent la volatilité. Le P5 peut même tomber à -3 %, ce qui rend les structures difficilement compatibles avec les attentes des prêteurs.
Dans ce contexte, les détenteurs historiques de ces actifs – notamment les fonds d’infrastructure ou les utilities fortement levierisés – se retrouvent face à des arbitrages complexes : vendre l’actif avec une décote, réinjecter du capital ou restructurer en internalisant la gestion du risque de prix.
Recomposition des profils d’investisseurs et stratégies de revente
La sortie d’actifs post-CfD des portefeuilles traditionnels crée des opportunités pour de nouveaux entrants spécialisés, notamment des fonds “merchant” et maisons de trading. Ces acteurs acceptent une volatilité plus forte en contrepartie de TRI plus élevés, comme le montre le cas d’un investisseur entrant à l’année 13 avec un TRI cible de 12,3 %.
En parallèle, les grands acheteurs industriels, notamment les data centres et les groupes électro-intensifs, renforcent leur pouvoir de négociation sur le marché des contrats d’achat d’électricité (PPA), profitant de la volonté des producteurs de sécuriser une part de leurs revenus sur le long terme.
Répercussions sur la gouvernance et la stratégie d’entreprise
La transformation du risque oblige les entreprises à revoir leurs processus internes. L’émergence de fonctions de trading, la refonte des indicateurs de performance centrés sur la valeur post-CfD et l’adaptation des politiques de rémunération deviennent incontournables. La rentabilité future dépend de la capacité à piloter activement la phase marchand.
Par ailleurs, le backlog de projets greenfield pourrait être affecté si les actionnaires jugent insuffisants les rendements des actifs en portefeuille. Ce contexte pourrait favoriser les développeurs disposant de bilans solides ou de stratégies “asset-light”, moins exposés aux arbitrages de capital.
Enjeux réglementaires et stabilité des soutiens publics
Les CfD sont désormais obligatoires dans les dispositifs d’aide d’État selon les lignes directrices CEEAG (Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines), mais leur caractère contractuel s’est affaibli face aux interventions d’urgence des États, comme les plafonds de revenus à 180 €/MWh ou les taxes sur les surprofits.
La combinaison d’une obligation réglementaire et d’une flexibilité politique accrue crée un régime hybride, où les revenus futurs dépendent autant des prix de marché que de décisions administratives imprévisibles. Dans ce cadre, la perception du risque sur les actifs renouvelables régulés se rapproche de celle d’infrastructures fossiles soumises à forte régulation.