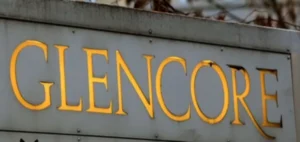Le gouvernement britannique a confirmé la mise en place d’un nouveau cadre fiscal durable pour les opérateurs pétroliers et gaziers, combinant une fiscalité de base à 40 % à une surtaxe temporaire prolongée jusqu’en 2030. Ce régime sera relayé par un dispositif permanent baptisé Oil and Gas Price Mechanism (OGPM), déclenché au-delà de seuils de prix élevés. Ce montage fige un prélèvement global de 75 à 78 %, malgré l’affaiblissement des cours du Brent et du National Balancing Point (NBP).
Un dispositif calibré pour capter les rentes cycliques
L’OGPM, conçu comme un successeur à la surtaxe exceptionnelle instaurée en 2022 (Energy Profits Levy – EPL), repose sur des seuils de déclenchement ajustés à l’inflation. L’objectif affiché est de garantir une certaine stabilité aux investisseurs. Toutefois, l’asymétrie structurelle demeure : en cas de baisse des prix, aucune compensation fiscale n’est prévue. L’outil offre donc à l’État une capacité accrue à capturer les revenus exceptionnels sans partager les risques baissiers.
Les investissements bénéficient toujours de mécanismes d’amortissement, mais l’effet de ces incitations diminue à mesure que les opérateurs privilégient d’autres juridictions. La Norvège, les États-Unis (golfe du Mexique) ou l’Afrique de l’Ouest présentent des régimes fiscaux plus compétitifs, attirant désormais une part croissante des capitaux.
Le signal d’une stratégie de déclin maîtrisé
Le maintien du prélèvement exceptionnel, en parallèle de l’introduction de l’OGPM, traduit une volonté de maximiser les recettes budgétaires tout en contenir les conséquences sociales. Le gouvernement autorise ainsi certains projets dits “tie-backs”, consistant à raccorder des gisements marginaux à des infrastructures existantes, sans rouvrir la porte aux licences d’exploration classiques. Ces décisions visent à préserver temporairement l’activité en mer du Nord, notamment en Écosse.
Les acteurs de taille moyenne comme Serica, Jersey Oil & Gas et NEO Energy concentrent leurs efforts sur ces redéveloppements. Le projet Greater Buchan Area en constitue un exemple emblématique, avec un CAPEX estimé à 850–950 M£ pour une production attendue de 70 à 100 millions de barils équivalent pétrole.
Impact différencié sur la chaîne de valeur
L’annonce ne devrait pas impacter immédiatement les prix du Brent ou du NBP, mais elle modifie le profil de risque fiscal associé aux projets britanniques. Les sociétés ajustent leurs portefeuilles en conséquence, prolongeant les délais de décisions finales d’investissement (FID) et privilégiant les modèles contractuels permettant de mutualiser les risques.
La chaîne d’approvisionnement offshore britannique subit une baisse de visibilité. Les fournisseurs, ingénieries et prestataires de services sous-marins font face à un report des commandes, les opérateurs redirigeant progressivement leurs budgets vers des bassins à fiscalité plus lisible.
Réactions et repositionnement des entreprises
Les groupes intégrés, dont INEOS Energy, commencent à repositionner la mer du Nord britannique comme un actif de fin de cycle, visant le rendement à court terme plutôt qu’un engagement industriel long. Les mid-caps doivent, quant à elles, justifier le maintien d’une exposition au UKCS dans un environnement fiscal instable.
Le risque de réputation pour le Royaume-Uni, historiquement perçu comme une juridiction fiscalement stable, s’intensifie. Depuis 2022, les révisions successives du cadre EPL ont dégradé cette perception. L’OGPM, même présenté comme prévisible, est déjà considéré comme un potentiel mécanisme à cliquet fiscal.
Conséquences géopolitiques et dépendance accrue
La trajectoire actuelle acte une baisse rapide de la production domestique et une dépendance croissante aux importations. La Norvège et les fournisseurs de gaz naturel liquéfié (LNG), notamment le Qatar et les États-Unis, deviennent des partenaires incontournables. Cette dépendance renforce la vulnérabilité du Royaume-Uni aux dynamiques internationales et aux tensions géopolitiques.
Londres accentue par ailleurs sa coordination énergétique avec l’Union européenne, notamment sur les interconnexions et les capacités de stockage. Le Royaume-Uni s’oriente vers un statut de consommateur structuré, davantage soumis aux fluctuations de marché qu’influenceur du mix énergétique régional.