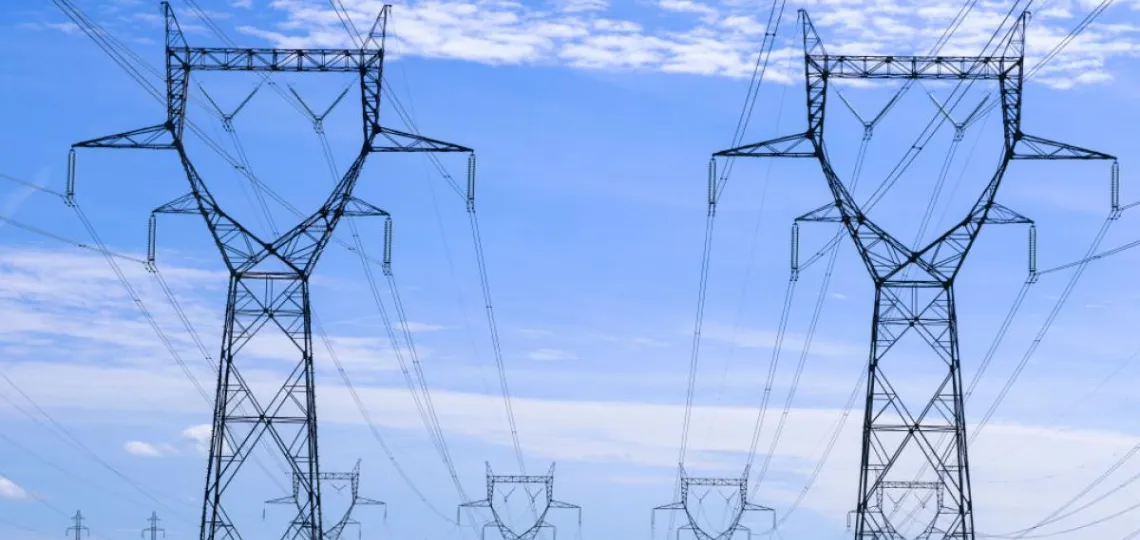Le Québec se retrouve isolé sur le plan fiscal environnemental, maintenant un prix du carbone sur l’essence et le gaz naturel pour les ménages, alors que le gouvernement fédéral a mis fin à la tarification carbone visible au détail dans les autres provinces. Ce changement fait suite à l’abandon par Ottawa, en avril 2025, de la redevance fédérale sur les combustibles, recentrant l’architecture réglementaire nationale sur les secteurs industriels.
Le Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE), qui s’applique au Québec depuis 2013, impose toujours un coût additionnel direct aux consommateurs. Lié au marché californien dans le cadre de la Western Climate Initiative (WCI), le SPEDE empêche toute réduction unilatérale de son prix plancher, actuellement autour de 40 $/t de CO₂, soit un impact d’environ 11 ¢/litre d’essence.
Un fardeau concentré sur les ménages
Selon une étude de l’Institut du Québec, le coût annuel de la tarification carbone québécoise varie entre 60 $ et 575 $ par ménage, selon le profil de consommation énergétique. Cette pression financière est particulièrement marquée chez les ménages ruraux ou dépendants du gaz naturel pour le chauffage. En revanche, l’impact reste marginal sur la majorité des biens de consommation, compte tenu de la faible diffusion du coût carbone dans les chaînes d’approvisionnement locales.
Les zones urbaines, mieux équipées en infrastructures de transport collectif et en chauffage électrique, subissent un effet beaucoup plus modéré. Cette disparité géographique alimente un sentiment d’injustice territoriale chez les populations périphériques, souvent plus dépendantes de la voiture individuelle.
Utilisation contestée des revenus du SPEDE
Le Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC), qui concentre les revenus issus des enchères du SPEDE, est au cœur des tensions politiques actuelles. Le projet de loi 7 prévoit la possibilité de transférer ces surplus vers le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), incluant des usages routiers traditionnellement exclus du périmètre climatique.
Des groupes de transport collectif et des acteurs institutionnels jugent que ce transfert dénature le principe même de la tarification carbone. Ils pointent un risque de perte de légitimité pour le SPEDE si ses recettes servent à financer les infrastructures qu’il est censé rendre obsolètes à terme.
Incidences pour les entreprises et les marchés
Le maintien d’un prix du carbone à la pompe crée un différentiel tarifaire avec les provinces voisines, qui pourrait favoriser l’arbitrage de consommation transfrontalier. Les distributeurs de carburant québécois situés près des frontières pourraient ainsi subir une baisse de volume, tandis que les flottes de transport cherchent à optimiser leur logistique énergétique.
Du côté industriel, la pression exercée par le SPEDE oriente les investissements vers des technologies plus sobres en carbone. Les entreprises soumises au système, notamment dans les secteurs du ciment, de l’aluminium et du gaz, doivent désormais intégrer un coût carbone interne dans leur planification stratégique.
Risques politiques et perception sociale
La combinaison d’une hausse modérée mais continue du prix carbone et d’une affectation budgétaire contestée nourrit une tension croissante autour de l’acceptabilité sociale du système. Les ménages québécois, seuls au pays à supporter un prix explicite à la pompe, sont de plus en plus sensibles aux écarts perçus avec le reste du Canada.
Le gouvernement québécois devra naviguer entre le maintien de sa crédibilité climatique dans le cadre de la WCI et les pressions internes pour assouplir la contrainte économique perçue. Toute décision de réaffectation des revenus climatiques ou de modification du SPEDE pourrait avoir des conséquences directes sur l’attractivité du Québec pour les investissements énergétiques à long terme.