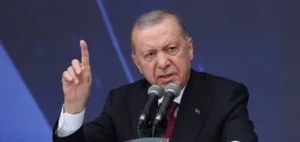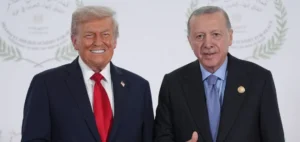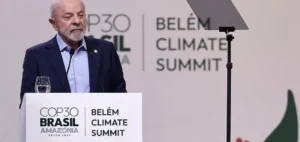La Russie a finalisé un accord nucléaire civil de vingt ans avec l’Iran, renforçant ainsi un partenariat qui suscite l’attention internationale. Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Téhéran détiendrait environ 275 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 %, un niveau jugé sensible. Les États-Unis, menés par le président Donald Trump, envisagent en parallèle de rouvrir des pourparlers indirects à Oman. Téhéran exige pour sa part la levée des sanctions économiques imposées depuis 2018, condition essentielle à toute avancée diplomatique.
Partenariat stratégique et enjeux internationaux
Le texte ratifié par la Douma prévoit la construction et la supervision de nouveaux réacteurs sur le site de Bushehr, avec un transfert de technologie de la part de Moscou. Certains observateurs soulignent la dimension stratégique de cette coopération, étant donné que les deux pays font l’objet de sanctions occidentales. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, a confirmé que la Russie soutenait toute initiative susceptible de réduire les tensions régionales. La possibilité d’une double utilisation des technologies nucléaires inquiète toutefois plusieurs acteurs, qui suivent de près l’évolution du programme iranien.
Le retrait américain de l’accord nucléaire international de 2015 a marqué un tournant, conduisant à la reprise de mesures punitives contre le secteur énergétique iranien. Washington affirme désormais être prêt à négocier, sous réserve de garanties iraniennes sur la nature exclusivement civile du programme nucléaire. Le président Donald Trump a évoqué la tenue de pourparlers directs, même si Téhéran persiste à privilégier un canal indirect. Des émissaires des deux camps s’apprêtent ainsi à se rencontrer séparément à Oman, nation historiquement engagée dans la médiation.
Négociations indirectes et réactions régionales
Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a souligné que son pays restait ouvert à un compromis, à condition que les sanctions américaines soient intégralement levées. Selon des sources officielles, le représentant spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, doit se rendre à Oman pour échanger avec des intermédiaires omanais et iraniens. Téhéran maintient toutefois qu’aucune rencontre directe n’est envisagée avec Washington. Les autorités iraniennes considèrent que la balle reste dans le camp américain, estimant avoir démontré leur volonté de respecter leurs engagements civils.
La Chine et la Russie, partenaires diplomatiques de longue date de l’Iran, soutiennent publiquement la voie de la négociation. Le Kremlin a réitéré son appui à toute solution politique visant à encadrer le programme nucléaire iranien, évoquant un potentiel de désescalade dans la région. Pékin a également appelé les parties à éviter toute provocation susceptible de compromettre les pourparlers. Ce climat d’ouverture témoigne d’une convergence d’intérêts entre les puissances souhaitant un apaisement, malgré des antagonismes persistants au niveau international.
Perspectives diplomatiques et surveillance de l’AIEA
L’Agence internationale de l’énergie atomique insiste sur la nécessité d’inspections renforcées, compte tenu de l’important stock d’uranium enrichi détenu par l’Iran. Les rapports des inspecteurs mettent en avant la coopération actuelle de Téhéran, tout en soulignant l’importance de la transparence pour éviter tout malentendu. Plusieurs gouvernements s’interrogent sur l’articulation entre le partenariat russo-iranien et les objectifs de non-prolifération, alors que l’accumulation de matières fissiles reste surveillée. Les pourparlers prévus à Oman et les échanges diplomatiques successifs pourraient influencer l’évolution de ce dossier, à la croisée de la géopolitique et du marché énergétique.