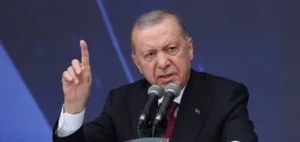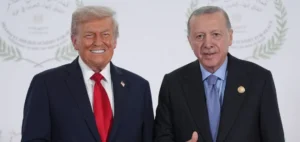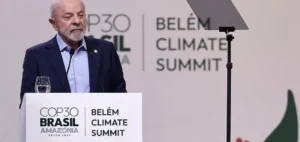Les négociations préparatoires à la Conférence des Parties (COP30), tenues à Bonn en juin, ont été marquées par des blocages répétés et des désaccords persistants sur les engagements financiers des pays développés envers les pays du Sud. Le retrait des États-Unis du processus a accentué les tensions, alors que la présidence brésilienne cherche à redéfinir les priorités de l’agenda climatique mondial.
Blocage initial et remise en question du processus COP
Dès l’ouverture, les travaux ont été retardés de deux jours en raison d’un différend sur l’ordre du jour, à la suite des demandes de plusieurs pays en développement d’inclure les obligations de financement des pays riches ainsi que les effets des mécanismes commerciaux, comme le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) de l’Union européenne. Ce blocage a ravivé les critiques sur l’inefficacité croissante du système COP, jugé trop lourd et peu opérationnel.
La présidence brésilienne a profité de la paralysie pour publier une lettre appelant à rationaliser le processus. La proposition de limiter les délégations nationales et de remplacer le consensus par un vote majoritaire a été évoquée sans qu’aucune décision ne soit prise. Le sujet devrait revenir au centre des débats à Belém.
Adaptation : avancées techniques et désaccords structurels
La réduction du nombre d’indicateurs du Global Goal on Adaptation (GGA), passé de plus de 9 000 à 490, a été l’un des rares progrès tangibles. Cependant, le désaccord sur l’inclusion des moyens de mise en œuvre – financement et transferts technologiques – dans les indicateurs-clés a empêché toute adoption définitive.
Les pays en développement ont insisté sur la nécessité d’un soutien financier concret pour élaborer et mettre en œuvre les Plans Nationaux d’Adaptation (PNA). Aucun compromis n’a été trouvé, et les discussions ont été reportées à la COP30, avec des documents finaux contenant de nombreuses réserves ou remplacés par des notes informelles sans portée juridique.
Mitigation et contributions nationales : un calendrier incertain
La remise des nouvelles Contributions Déterminées au niveau National (CDN), attendues en février, a été massivement retardée. La date limite a été repoussée à septembre, après quoi le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) évaluera leur compatibilité avec l’objectif de 1,5°C.
Le Bilan mondial (Global Stocktake) de la COP28, proposant de tripler la capacité renouvelable, de doubler l’efficacité énergétique et d’initier la sortie des énergies fossiles, reste un point de friction. Plusieurs pays du Sud demandent que ces ambitions soient assorties de garanties de financement, conditionnant leur adhésion à l’ampleur du soutien offert.
Le Fonds pour pertes et dommages à l’arrêt
Moins de $350 millions ont été effectivement déboursés sur les $768 millions promis au Fonds pour pertes et dommages, hébergé par la Banque mondiale. Le mécanisme, salué à Dubaï, suscite désormais des critiques virulentes. Plusieurs délégations ont demandé une évaluation indépendante sous l’égide du Mécanisme international de Varsovie.
Les discussions devraient s’intensifier à Belém, notamment sur l’intégration d’une part dédiée au Fonds dans le nouvel objectif collectif quantifié (NCQG), dont les contours restent flous depuis son adoption à Bakou.
Roadmap de Bakou à Belém : entre ambition et réalisme
Le Brésil et l’Azerbaïdjan pilotent une feuille de route visant à définir les étapes permettant d’atteindre $1 300 milliards de financement climatique d’ici 2035, en réponse à un NCQG jugé insuffisant par le Sud. Les discussions à Bonn ont exploré les mécanismes potentiels, incluant réformes bancaires multilatérales, réductions des coûts du capital et création de « clubs climatiques » finance-technologie.
Les prochaines étapes dépendront de la capacité des pays développés à intégrer ces demandes dans les négociations officielles. L’issue pèsera lourd sur la légitimité du processus COP aux yeux des pays les plus vulnérables.
Pressions sur le Brésil en tant que producteur fossile
L’annonce par le régulateur brésilien de l’attribution prochaine de 172 blocs pétroliers, dont plus de 40 en Amazonie, a généré des critiques internationales. Le contraste entre cette initiative et les objectifs de transition affichés à la COP nourrit un climat d’incompréhension, même au sein du comité d’organisation. Le gouvernement brésilien défend sa position en invoquant le droit au développement énergétique, tout comme d’autres pays producteurs.