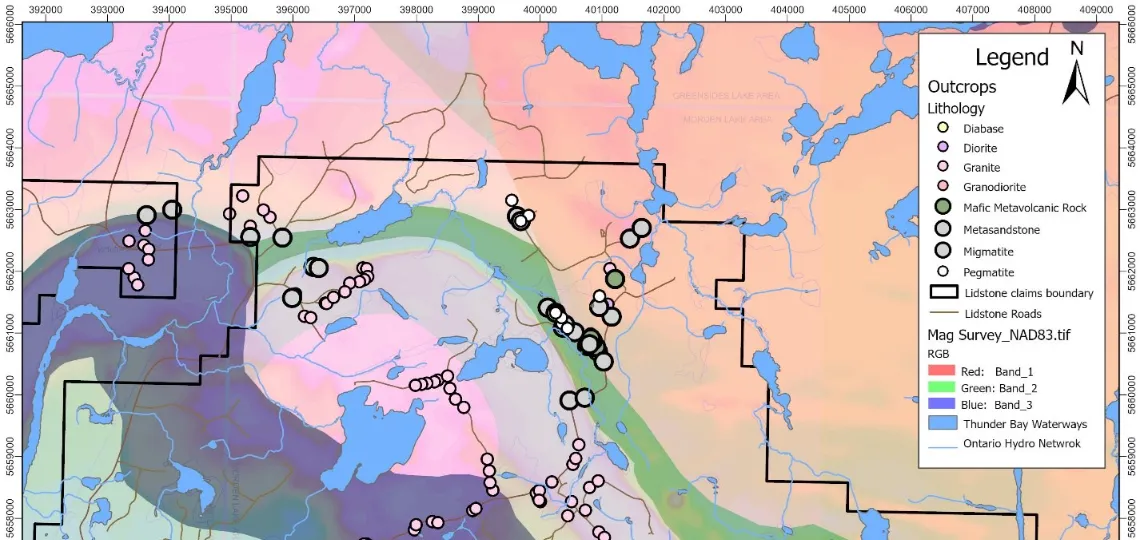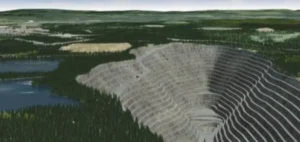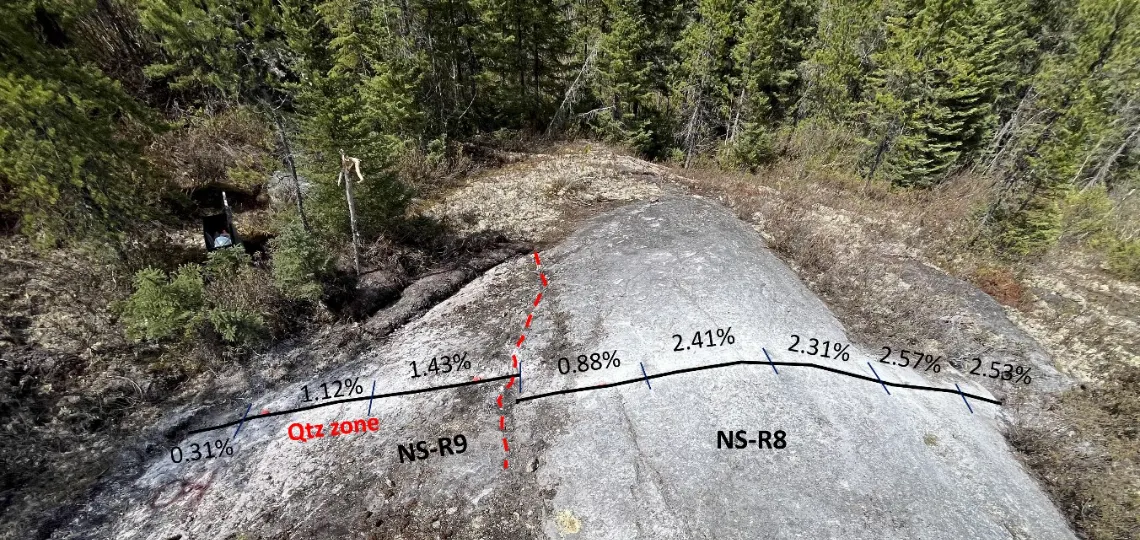L’Union européenne a intensifié ses critiques contre les contrôles chinois visant les exportations de terres rares, qualifiés de « racket » par le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Les industriels européens considèrent que ces mesures transforment un mécanisme administratif en instrument de pression sur des secteurs essentiels tels que l’automobile, les énergies renouvelables et l’aéronautique. Cette mise en cause intervient alors que la Chine applique depuis plusieurs mois un système de licences particulièrement détaillé pour les métaux et technologies contenant des intrants d’origine chinoise.
Un dispositif de contrôle complexe imposé par Pékin
Le ministère chinois du Commerce (MOFCOM) requiert désormais que chaque exportation de terres rares ou de produits transformés fasse l’objet d’une licence spécifique. Cette exigence couvre les oxydes, les alliages, les aimants permanents et certaines technologies industrielles, y compris pour les produits fabriqués hors de Chine intégrant des composants chinois. Le gouvernement chinois invoque des considérations de sécurité nationale pour justifier ce cadre, s’inscrivant dans une logique comparable aux pratiques du Bureau of Industry and Security (BIS) ou de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) aux États-Unis.
En novembre, la Chine a suspendu pour un an une partie des exigences introduites à l’automne, dans le cadre d’un accord discuté prioritairement avec les États-Unis. Cette suspension n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux règles adoptées plus tôt dans l’année, qui demeurent effectives. Les entreprises européennes se trouvent ainsi confrontées à une réglementation partiellement gelée mais toujours structurante pour leurs approvisionnements.
Une dépendance persistante pour les industriels européens
La Chine assure environ sept dixièmes de la production mondiale de terres rares et plus de 90 % du raffinage, ce qui lui confère une position dominante sur des intrants utilisés dans les véhicules électriques, les turbines éoliennes et diverses applications militaires. Les industriels européens doivent composer avec des capacités locales limitées, malgré la présence d’acteurs opérant dans la transformation ou le recyclage sur le continent.
Les modalités imposées par MOFCOM obligent les entreprises à fournir des informations précises sur les usages finaux, les clients et les chaînes d’approvisionnement. Pour les groupes européens, ces demandes représentent un enjeu organisationnel majeur, car elles impliquent la divulgation d’éléments sensibles relatifs à leur fonctionnement interne et à leurs débouchés.
Le rôle du CRM Act et les ambitions de ResourceEU
L’Union européenne tente de renforcer sa résilience via le Critical Raw Materials Act (CRM Act), qui vise à développer l’extraction, le raffinage et le recyclage sur le territoire européen d’ici 2030. Le projet ResourceEU, présenté comme un futur centre d’achat et de coordination pour les matières premières critiques, doit permettre de mutualiser la demande et de créer des stocks. Toutefois, son périmètre opérationnel reste limité faute de budget dédié et de compétences centralisées.
La gouvernance du dispositif s’appuie largement sur les États membres, qui conservent la responsabilité des projets miniers et des accords commerciaux. Cette architecture institutionnelle réduit la capacité de l’Union à mener des négociations internationales structurantes pour sécuriser des volumes hors de Chine.
Conséquences industrielles et pression sur les marchés
Le durcissement réglementaire a déjà provoqué des fluctuations significatives sur les marchés, avec une hausse des prix spot et des valeurs boursières des producteurs chinois. Les industriels européens doivent revoir leurs stratégies d’approvisionnement, augmenter leurs stocks et intégrer davantage de risques réglementaires dans leurs contrats. Ces ajustements mobilisent du capital et peuvent retarder certains projets liés aux véhicules électriques ou aux infrastructures énergétiques.
Les coûts supplémentaires associés aux clauses réglementaires, aux délais administratifs et aux obligations d’information s’ajoutent aux tensions existantes sur les chaînes d’approvisionnement. Les entreprises doivent également anticiper les effets potentiels d’un éventuel rétablissement complet des contrôles chinois après la période de suspension actuelle.
Un dossier susceptible d’évoluer au plan multilatéral
Le qualificatif de « racket » utilisé par Bruxelles pourrait alimenter un débat plus large sur l’équilibre des pratiques commerciales internationales. Cette rhétorique pourrait servir à préparer un recours à l’Instrument anti-coercition (ACI) ou favoriser une discussion au sein de l’Organisation mondiale du commerce (WTO). Une telle démarche dépendrait néanmoins de l’alignement des États membres et de la capacité à démontrer le caractère discriminatoire ou disproportionné des mesures chinoises.
La coordination internationale devient un enjeu central alors que les États-Unis, le Japon ou la Corée du Sud poursuivent leurs propres stratégies pour sécuriser leurs approvisionnements hors de Chine. L’Union européenne doit désormais s’interroger sur sa capacité à défendre ses intérêts dans un environnement où la concurrence pour l’accès aux métaux stratégiques s’intensifie.