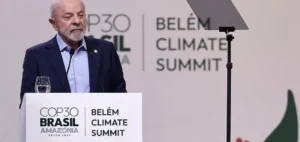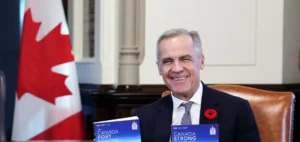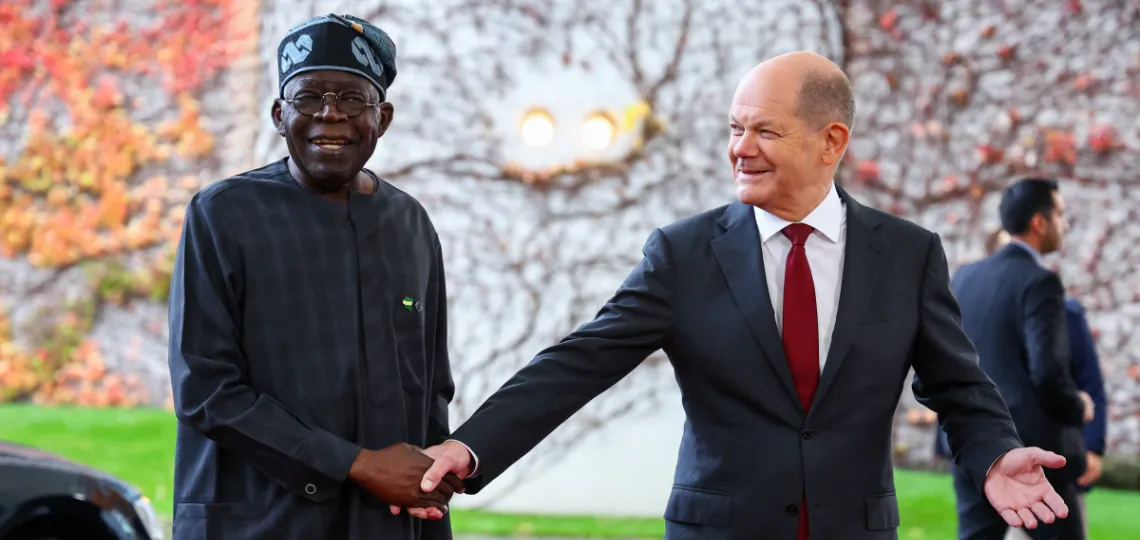Plusieurs petits États membres de l’Union européenne investissent le champ africain à travers une série d’initiatives diplomatiques, économiques et technologiques visant à capter des flux liés au programme Global Gateway. Cette stratégie européenne prévoit plus de €400bn ($436bn) d’investissements mondiaux d’ici 2027, dont près de la moitié en Afrique, principalement dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et du numérique.
Des positions ciblées sur des marchés sous-exploités
La Finlande a ouvert une ambassade à Dakar, conçue comme un point d’ancrage pour ses entreprises opérant dans l’hydroélectricité, le numérique et les services publics. L’Estonie déploie ses technologies d’interopérabilité administrative (X-Road) et d’identification numérique en Namibie, au Rwanda et au Kenya, dans une logique d’exportation institutionnelle. De son côté, la Hongrie s’est implantée diplomatiquement et militairement au Tchad, avec une promesse de soutien de €200mn ($218mn), visant les enjeux de sécurité et de contrôle migratoire. La Tchéquie, quant à elle, s’est engagée dans la formation militaire et le soutien à l’industrie de défense légère en Mauritanie.
Accès aux ressources critiques et corridors énergétiques
Les États nouvellement actifs misent sur la sécurisation des approvisionnements en minerais critiques essentiels aux transitions énergétiques européennes. L’Union européenne a signé un accord stratégique avec l’Afrique du Sud sur ces ressources, ciblant leur transformation locale pour alimenter les secteurs européens des batteries, des éoliennes et des semi-conducteurs. Parallèlement, des projets de mini-réseaux électriques, de lignes à haute tension et d’électrification rurale financés par Global Gateway sont en cours en Côte d’Ivoire, au Lesotho et à Madagascar, offrant aux nouveaux entrants un espace pour déployer leur ingénierie et leur expertise sectorielle.
Redistribution de l’influence diplomatique européenne
Ce repositionnement modifie l’équilibre traditionnel de l’Union européenne en Afrique. En s’implantant hors du champ d’influence des anciennes puissances coloniales, notamment au Sahel, ces pays créent de nouveaux hubs d’influence à Nairobi, Windhoek ou N’Djamena. Leur neutralité historique vis-à-vis du passé colonial et leur profil non interventionniste leur permettent de maintenir des partenariats dans des contextes politiques sensibles, où la présence française ou allemande devient plus fragile.
Contraintes de ressources et coordination intra-européenne
Malgré leur activisme, ces petits États disposent de ressources limitées. Certaines ambassades couvrent plusieurs pays à la fois avec peu de personnel. Les missions militaires ou techniques reposent souvent sur des effectifs restreints, sans capacités de projection prolongée. Ce déficit structurel complique la mise en œuvre de projets complexes dans des contextes instables, d’autant plus que la coordination avec d’autres initiatives européennes reste faible, augmentant les risques de redondance et de fragmentation stratégique.
Effets attendus sur les chaînes d’approvisionnement européennes
Leur implication permet toutefois d’amplifier la dynamique des projets Global Gateway et d’élargir l’offre européenne face à la concurrence chinoise, russe ou turque. En renforçant les corridors énergétiques, numériques et logistiques, ces États contribuent à diversifier les sources d’approvisionnement de l’Union européenne et à relocaliser une partie des chaînes de valeur hors d’Asie. Ils peuvent aussi jouer un rôle de leaders techniques sur certaines filières spécifiques comme l’hydrogène vert, les smart grids ou la gouvernance numérique.
Exposition accrue aux risques politiques et juridiques
La stratégie comporte néanmoins des risques. L’instabilité politique dans des pays comme le Sénégal ou la Namibie, considérés aujourd’hui comme stables, pourrait remettre en cause certains partenariats. La conformité avec les régimes de sanctions européens et internationaux demeure une contrainte pour les opérateurs engagés dans des zones où sont actifs des groupes liés à la Russie. Les entreprises nationales intervenant via des canaux bilatéraux s’exposent également à des revirements de politique étrangère liés aux cycles électoraux dans leur propre pays.