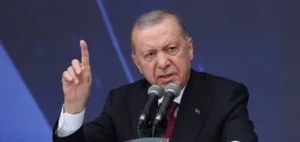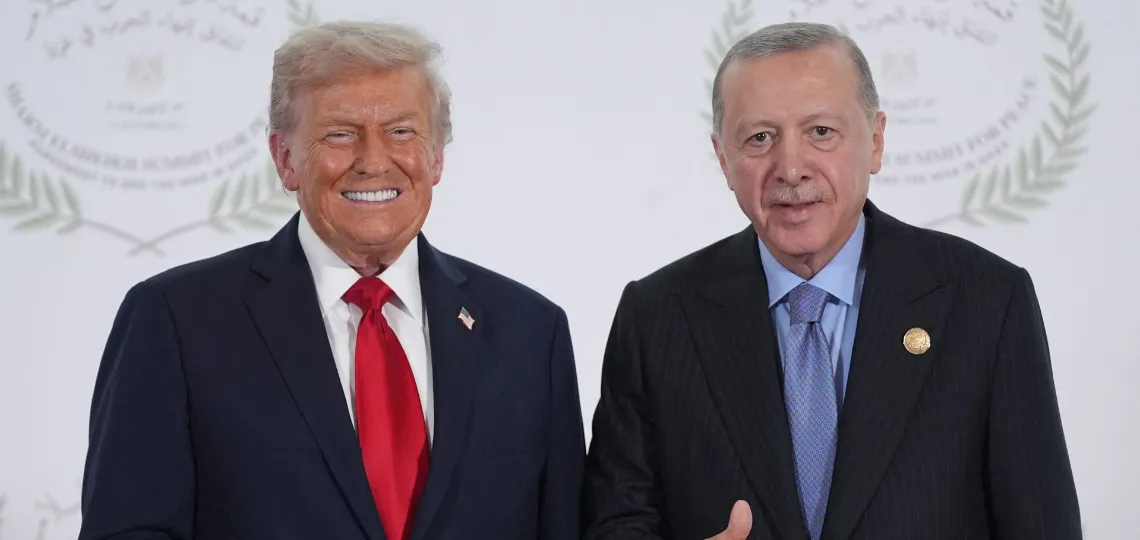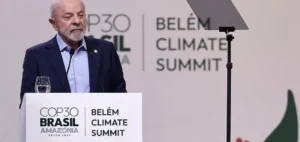L’ouverture officielle de la COP30 à Belém, au Brésil, marque le début de deux semaines de négociations intensives entre près de 200 délégations nationales. Dès les premières heures, les discussions se sont heurtées à un désaccord majeur sur la définition de l’agenda, condition essentielle pour aborder les thèmes du financement, de la réduction des émissions et de l’adaptation. Les échanges, prolongés jusqu’à tard dans la nuit, n’ont pas permis d’aboutir à un consensus, révélant une polarisation croissante entre pays producteurs d’hydrocarbures et États les plus vulnérables aux impacts climatiques.
Un blocage révélateur des fractures diplomatiques
Le Groupe des pays en développement aux vues similaires (Like-Minded Developing Countries), qui rassemble notamment l’Arabie saoudite et l’Inde, a insisté pour placer au cœur de l’agenda la question du financement climatique promis par les pays développés. En parallèle, l’Alliance des petits États insulaires (Alliance of Small Island States) a plaidé pour une discussion sur les écarts entre les engagements actuels et les trajectoires nécessaires pour contenir le réchauffement à 1,5°C. Ces divergences d’intérêts ont paralysé les discussions, le consensus étant indispensable pour valider la liste des points à débattre.
Cette impasse illustre la difficulté de concilier des priorités diplomatiques divergentes : d’un côté, les pays producteurs défendent la continuité économique de leurs exportations énergétiques ; de l’autre, les nations exposées aux catastrophes climatiques réclament des mesures urgentes et un soutien financier renforcé.
Pression accrue sur la transition fossile
Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a appelé, lors de son discours inaugural, à l’élaboration d’une feuille de route mondiale pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. Malgré l’accord de transition conclu à la COP28, aucun des soixante plans climatiques actualisés depuis n’inclut de cibles concrètes de réduction de la production de pétrole et de gaz. Le Secrétaire exécutif du sommet, André Aranha Corrêa do Lago, a déclaré que « tous les pays producteurs ont reconnu la nécessité d’une transition », estimant qu’un mandat international existe pour engager ces discussions.
Les pays développés souhaitent désormais recentrer le débat sur la mitigation, après avoir mobilisé $1 300bn lors des précédents engagements financiers. Cependant, sans feuille de route opérationnelle, les engagements de transition risquent de rester symboliques.
Un sommet marqué par l’incertitude américaine
Les États-Unis, qui prévoient de se retirer officiellement de l’Accord de Paris au 27 janvier prochain, n’ont pas encore enregistré de délégation à Belém. Cette absence nourrit des interrogations sur la continuité de leur engagement diplomatique. Toutefois, le pays demeure signataire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ce qui autorise sa participation à tout moment jusqu’à la clôture du sommet.
Cette situation fragilise la cohésion des négociations, d’autant que la politique énergétique américaine, sous la présidence de Donald Trump, privilégie la production nationale d’énergies fossiles et une réduction des contraintes environnementales internationales.
L’adaptation comme terrain potentiel de compromis
Bien qu’aucune avancée majeure ne soit attendue cette année, la question de l’adaptation pourrait offrir une base de convergence. Les discussions portent sur la réduction d’une liste de 400 indicateurs de résilience climatique à une centaine, dans le but d’établir des critères harmonisés d’évaluation des politiques publiques.
L’objectif actuel de doubler le financement de l’adaptation, qui expire cette année, pourrait être remplacé par un nouveau mécanisme. Plusieurs délégations défendent la création d’un cadre financier permanent pour soutenir les pays les plus exposés, notamment après le passage de l’ouragan Melissa en Jamaïque, dont les dégâts sont estimés à $4.2bn.