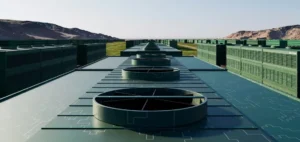Le gouvernement du Pérou a officiellement lancé une nouvelle version de ses Contributions Déterminées au niveau National (NDC 3.0), mettant l’accent sur les mécanismes de marché prévus à l’Article 6 de l’Accord de Paris et sur l’utilisation des résultats d’atténuation transférés internationalement (ITMO). Cette nouvelle feuille de route climatique fixe un plafond d’émissions de 179 millions de tonnes de dioxyde de carbone équivalent (mtCO2e) pour l’année 2035, tout en réaffirmant l’ambition d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Une stratégie centrée sur les transferts carbone internationaux
Au cœur de cette stratégie, le Pérou prévoit de recourir à au moins 9 millions de mtCO2e d’ITMOs pour contribuer à ses objectifs d’atténuation. Ces crédits, reconnus dans le cadre de l’Accord de Paris, peuvent être transférés entre pays, ouvrant la voie à des accords bilatéraux tels que celui déjà signé avec Singapour. Ce dernier est entré en vigueur le 18 octobre et pourrait faciliter les premiers échanges de crédits REDD+.
REDD+ (Réduction des Émissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts) reste un pilier central de la stratégie péruvienne, avec un soutien affirmé à 66 mesures sectorielles d’atténuation. Ces mesures couvrent des secteurs allant de l’agriculture à la gestion des ressources forestières, avec une attention particulière portée à l’amélioration du suivi des émissions.
Renforcement des outils nationaux de suivi des émissions
Pour garantir la transparence et l’intégrité de ses engagements, le Pérou déploie deux instruments clés : Huella de Carbono Perú (Empreinte Carbone Pérou) et le Registre National des Mesures d’Atténuation (RENAMI). Le premier, destiné aux organisations publiques et privées, permet de mesurer, consigner et gérer les émissions de gaz à effet de serre selon un système de reconnaissance progressive. Le second sert à enregistrer, suivre et administrer les réductions d’émissions ou augmentations d’absorptions à l’échelle nationale.
Les acteurs du marché surveillent de près le développement de ces instruments, certains soulignant encore des incertitudes réglementaires. Les crédits carbone issus des projets REDD+ péruviens sont intégrés dans les évaluations régionales, avec des prix variant fortement selon la qualité des projets et les co-bénéfices associés.
Un marché en construction autour de l’Article 6
Le prix évalué par Platts pour les crédits REDD+ en Amérique du Sud est resté stable à $6.80/mtCO2e, selon les dernières données du marché. Toutefois, certains développeurs locaux rapportent que les projets de meilleure qualité, comme Tambopata REDD+ 1067, se négocient à des niveaux plus élevés, entre $12 et $13/mtCO2e. Ces écarts illustrent les disparités actuelles de valorisation au sein du marché volontaire du carbone, notamment dans les contextes où les cadres réglementaires restent en évolution.
Un opérateur basé au Pérou a noté que « la qualité des projets et leur capacité à générer des bénéfices sociaux et environnementaux tangibles sont aujourd’hui les principaux moteurs de différenciation tarifaire ».