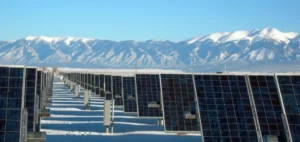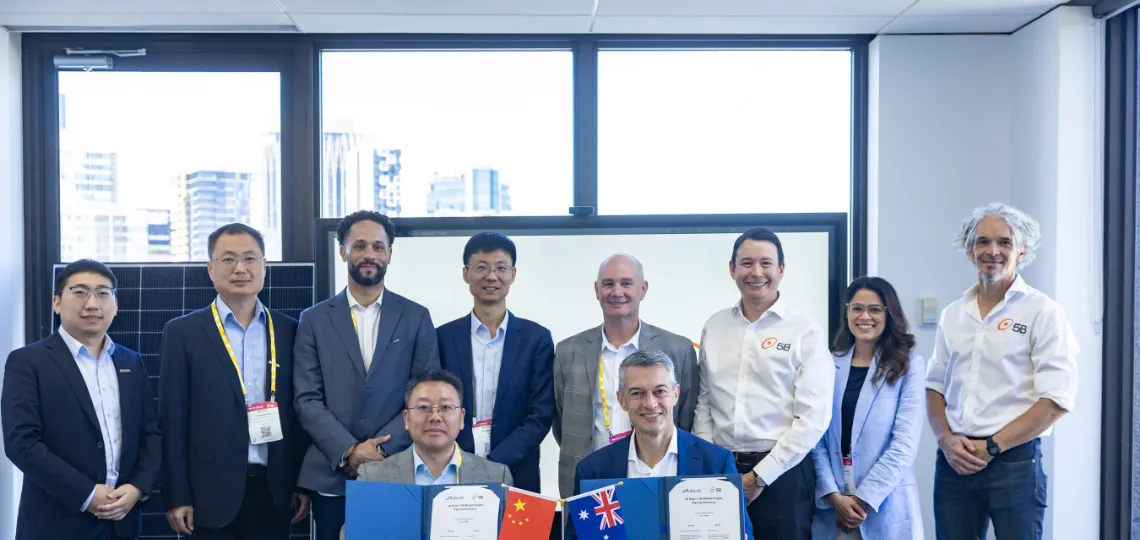La Chine met fin à une ère de prix artificiellement bas dans le solaire. La suppression progressive du rabais de 13 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les exportations de modules photovoltaïques intervient après une année marquée par une chute historique des prix jusqu’à 0,07 à 0,09 dollar le watt, contre 0,25 dollar en 2021. Ce virage fiscal et industriel s’inscrit dans une stratégie plus large de reprise de contrôle d’un marché qui avait sombré dans une guerre des prix dévastatrice pour les fabricants chinois. Selon plusieurs analyses de marché, cette décision pourrait faire grimper les prix de 9 % dès le quatrième trimestre 2025, puis de 5 à 7 % supplémentaires en 2026.
Une intervention coordonnée pour stabiliser la filière
Les autorités chinoises ont imposé aux producteurs de polysilicium, de wafers et de cellules solaires une réduction volontaire de la production estimée à près d’un tiers des capacités nationales, soit environ un million de tonnes de polysilicium. Les principaux groupes concernés – Tongwei, Daqo New Energy, GCL Technology et Xinte Energy – ont accepté de limiter leurs volumes pour rétablir la rentabilité du secteur. Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information a parallèlement renforcé les normes d’efficacité énergétique, forçant la fermeture d’une centaine d’usines jugées obsolètes. Cette politique vise à créer une consolidation interne comparable à celle de l’industrie sidérurgique chinoise au début des années 2010.
Un choc immédiat pour les développeurs internationaux
Les développeurs solaires, notamment en Europe et aux États-Unis, se préparent à une révision forcée de leurs contrats d’approvisionnement. Les livraisons prévues après novembre 2025 devraient faire l’objet de renégociations tarifaires, certaines clauses d’ajustement étant désormais activées. En Europe, le coût moyen des centrales solaires au sol pourrait augmenter de 5 à 8 %, ce qui affecterait les niveaux de rentabilité (LCOE) et repousserait les délais de bouclage financier de nombreux projets. Aux États-Unis, la dépendance à l’égard des importations chinoises reste supérieure à 70 % malgré le Inflation Reduction Act (IRA), exposant les développeurs américains à des tensions similaires.
Des tensions commerciales et réglementaires en toile de fond
Ce réajustement coïncide avec un durcissement mondial des règles commerciales. Le Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) aux États-Unis a déjà conduit à la détention de plus de 16 000 cargaisons de composants solaires depuis 2022, représentant plus de 3,5 milliards de dollars. L’Union européenne a de son côté enclenché plusieurs enquêtes sur les subventions publiques accordées par Pékin à ses producteurs photovoltaïques, tout en évitant de bloquer les importations par crainte d’un ralentissement de ses objectifs climatiques. En Inde, le gouvernement a abaissé les droits de douane sur les modules à 20 %, tout en envisageant de nouvelles taxes antidumping sur les cellules chinoises pour protéger sa filière locale.
Un rééquilibrage global des flux et des stratégies industrielles
La décision chinoise aura un effet domino sur les marchés émergents. Les pays du Golfe, notamment le Qatar et l’Arabie saoudite, déjà engagés dans d’importants programmes solaires, devront composer avec des coûts d’importation plus élevés pour leurs appels d’offres en 2026. Les développeurs asiatiques cherchent déjà à diversifier leurs sources vers la Malaisie et le Vietnam, où plusieurs lignes d’assemblage ont été relocalisées par des groupes chinois pour contourner les barrières douanières. En Europe, les industriels tentent de relancer la production domestique, mais leurs coûts restent supérieurs de 30 à 40 % à ceux de la Chine.
Vers une nouvelle hiérarchie du marché photovoltaïque
La Chine conserve près de 82 % des capacités mondiales de production de modules, mais cette réforme fiscale et industrielle lui permet désormais d’en contrôler le prix plancher. En s’éloignant du modèle d’exportation à marge nulle, Pékin transforme la logique du marché mondial : la hausse des prix devient un instrument de régulation plutôt qu’un signe de déséquilibre. Ce repositionnement redéfinit la hiérarchie des acteurs et pourrait encourager une régionalisation accrue des chaînes d’approvisionnement. Pour les investisseurs, cette évolution marque la fin d’un cycle déflationniste et l’ouverture d’une période de coûts stabilisés mais plus élevés.