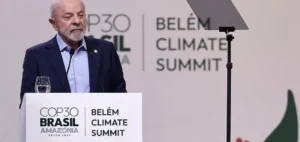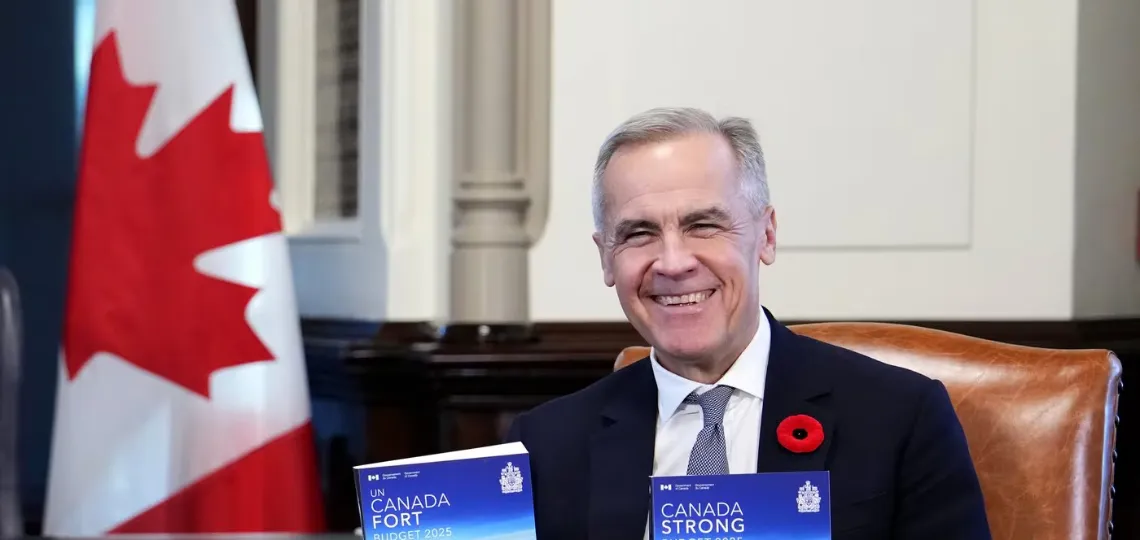L’accord commercial conclu entre l’Union européenne et les États-Unis prévoit des achats énergétiques européens d’une ampleur sans précédent. L’engagement de 750 milliards de dollars sur trois ans représente plus du triple des importations actuelles de l’UE en provenance des États-Unis. Cette somme équivaudrait à près de 80% du total des exportations énergétiques américaines mondiales, qui s’élevaient à 318 milliards de dollars en 2024. Les analystes du secteur énergétique questionnent la capacité des deux parties à atteindre ces objectifs ambitieux dans le contexte actuel du marché.
Des contraintes d’approvisionnement majeures
Les États-Unis devraient réorienter massivement leurs flux d’exportation pour satisfaire la demande européenne. Actuellement premier fournisseur de gaz naturel liquéfié (GNL) de l’Europe avec 44% des besoins, et pourvoyeur de 15,4% du pétrole européen, les États-Unis font face à une équation complexe. La production américaine de GNL devrait connaître une expansion bien supérieure aux capacités prévues jusqu’en 2030 pour répondre à ces engagements. Parallèlement, d’autres partenaires commerciaux comme le Japon et la Corée du Sud ont également signé des accords pour augmenter leurs importations d’énergie américaine, créant une compétition internationale pour des ressources limitées.
Le marché européen présente ses propres défis structurels. La demande pétrolière du continent a atteint son pic il y a plusieurs années et poursuit sa décroissance, dans un contexte de transition énergétique. Le secteur du raffinage européen traverse une phase de contraction importante, avec environ 900 000 barils par jour de capacité de raffinage qui devraient fermer en 2025. Cette réduction de capacité limite mécaniquement la capacité d’absorption de pétrole brut supplémentaire. De plus, les raffineries européennes, historiquement configurées pour traiter du pétrole moyen et lourd, rencontrent des difficultés techniques avec le pétrole léger américain West Texas Intermediate (WTI) Midland, qui produit davantage d’essence et moins de diesel et de kérosène.
L’absence de mécanismes contraignants
L’architecture institutionnelle européenne ne permet pas d’imposer des achats énergétiques aux acteurs privés. Les importations de pétrole et de gaz sont majoritairement réalisées par des entreprises privées qui prennent leurs décisions d’achat selon des critères commerciaux. La Commission européenne peut faciliter les négociations et agréger la demande pour obtenir de meilleures conditions, mais elle ne dispose d’aucun pouvoir coercitif sur les décisions d’achat. Cette réalité structurelle limite considérablement la capacité de l’UE à garantir le respect de ses engagements d’achat.
Les responsables européens reconnaissent ces contraintes tout en maintenant que les objectifs restent atteignables moyennant des investissements massifs. Ces investissements concerneraient les infrastructures d’exportation américaines, les capacités d’importation européennes et les moyens de transport maritime. Cependant, l’ampleur des transformations nécessaires soulève des questions sur la faisabilité dans les délais impartis. Les analystes du secteur estiment qu’une augmentation de 50 milliards de dollars des importations de GNL américain représenterait déjà un objectif ambitieux mais plus réaliste.
Un contexte commercial plus large
L’engagement énergétique s’inscrit dans un accord commercial global qui prévoit également l’application de droits de douane de 15% sur la plupart des exportations européennes vers les États-Unis, contre 4,8% avant l’administration actuelle. L’accord comprend aussi 600 milliards de dollars d’investissements européens aux États-Unis sur la période. Des négociations sectorielles se poursuivent pour définir les exemptions possibles et les conditions spécifiques pour certains secteurs comme l’acier, les produits pharmaceutiques ou les vins et spiritueux.
L’objectif affiché de remplacer les importations russes d’énergie ajoute une dimension géopolitique à ces engagements économiques. L’UE importait environ 94 millions de barils de pétrole russe et 52 milliards de mètres cubes de gaz russe en 2024. La substitution complète de ces volumes par des sources américaines nécessiterait une reconfiguration majeure des flux énergétiques mondiaux. Cette transformation pourrait également exercer une pression à la hausse sur les prix de l’énergie, créant des défis politiques et économiques pour les dirigeants des deux côtés de l’Atlantique.